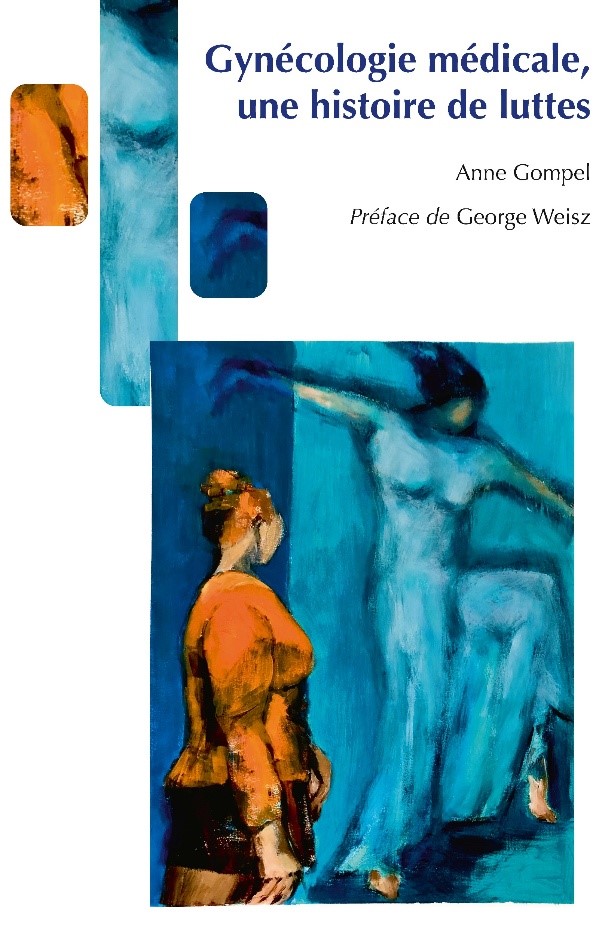Par Anne Gompel, Pr. émérite de l’université Paris Cité, présidente honoraire du CNEGM
La gynécologie médicale est actuellement une spécialité française. Elle existe en France sous ce nom depuis le XIXème siècle, où le terme de gynécologie a succédé au terme antérieur de « prise en charge des maladies des femmes », remontant à l’antiquité, dans le premier tiers du XIXème siècle. Elle a pu exister sous des formes différentes dans d’autres pays mais n’a été vraiment développée et institutionnalisée qu’en France. J’ai donc mené des recherches qui ont permis de mettre en lumière des faits qui ont très vraisemblablement contribué à sa pérennisation dans notre pays, car son histoire n’était pas écrite.
La France est particulière par le fait que la chirurgie gynécologique et l’obstétrique ont été longtemps séparées. La chirurgie gynécologique s’est développée grâce à une grande école française de gynécologie chirurgicale, créée par Samuel Pozzi, à la fin du XIXème siècle, et poursuivie par ses successeurs, l’école Broca. La chirurgie gynécologique est restée longtemps séparée de l’obstétrique selon le vœu de cette école. Ce n’est qu’en 1941, que le Conseil de l’Ordre des médecins, créé par le gouvernement de Vichy, a réuni les spécialités de chirurgie gynécologique et d’obstétrique. La gynécologie médicale existait au XIXème siècle, et était pratiquée par des médecins des hôpitaux, académiciens et praticiens exerçant en ville. Des traités de gynécologie rédigés par des chirurgiens et médecins en attestent. L’école Broca a développé un enseignement de gynécologie médicale et chirurgicale à la fin du XIXème siècle et au XXème siècle. Elle a donc joué un rôle majeur dans le développement et la formation des gynécologues médicaux à cette période. Ces chirurgiens travaillaient en bonne entente et collaboration avec les médecins et les obstétriciens pour le bien de la santé des femmes.
Nous pensons aussi qu’ont joué un rôle essentiel dans le développement et la pérennisation de cette spécialité, des personnalités emblématiques, militantes de la contraception, de la sexualité et de l’avortement et des scientifiques qui ont développé des écoles universitaires alliant recherche clinique et biologique. Parmi les militants, Jean Dalsace, a été particulièrement pionnier, visitant dès 1929 le planning familial américain, développé grâce à Margaret Sanger et avec l’aide de deux médecins Hannah et Abraham Stone, alors qu’existait en France une loi (de 1920) prohibant la promotion et l’enseignement de la contraception. Il est revenu et a développé en France des consultations de contrôle des naissances et de fertilité dans un dispensaire (ayant été congédié de l’APHP en raison de la loi de 1920), s’est engagé politiquement, a créé avec le Dr Toulouse l’association de sexologie (1931). Marie-André Lagroua-Weill-Hallé, gynécologue médicale, venant d’un milieu catholique, initialement opposée à la contraception, mais très choquée par les conséquences des avortements et des grossesses multiples pour les femmes, a eu le courage d’affronter l’Académie des Sciences pour dénoncer la loi de 1920 et a créé le planning familial français avec l’aide d’Evelyne Sullerot.
Parmi les scientifiques, le Pr. Albert Netter devient chef de service en 1949 et va développer la gynécologie endocrinienne moderne. Il s’entoure de collaborateurs et de collaboratrices de talent et va en aborder tous les aspects dans son service, chacun étant confié à un.e. collaborateur(trice), y compris la contraception bien que prohibée par la loi, mais aussi les aménorrhées et les troubles du cycle, la sénologie, la ménopause, l’infertilité…. Innovateur, créatif, brillant, il sera à l’origine d’enseignements de gynécologie endocrinienne. Il a développé une collaboration avec un chirurgien gynécologue également très brillant, le Pr. René Musset. Ensemble ils ont pu faire avancer les connaissances en gynécologie organique. Max Jayle, biochimiste de grand talent a aussi permis, en mettant au point les dosages hormonaux à l’école de Netter, de décrire les aspects biologiques des troubles du cycle, de la puberté, de la ménopause… Le Pr. Pierre Mauvais-Jarvis a succédé à Netter, s’est lui aussi entouré de collaboratrices de talent et a poursuivi les thématiques de la gynécologie endocrinienne. Outre le service clinique dont il a pris la succession, il a développé une recherche plus biologique dans son laboratoire s’intéressant surtout aux androgènes et à l’hormonodépendance de la glande mammaire. Pionnier du traitement moderne de la ménopause, ayant suivi les travaux de Max Jayle qui avait initié l’estradiol percutané, il a développé le traitement hormonal associant estradiol extra-digestif et progestérone micronisée.
L’histoire récente :
Spécialité exercée en majorité par des femmes (90/95% des gynécologues médicaux sont des femmes), elle fut supprimée en 1982-86 lors de la création du nouveau mode de spécialisation par les diplômes d’études spécialisées (DES), seule spécialité à avoir été alors supprimée. Une forte mobilisation initiée par le Dr. Dominique Malvy, gynécologue médicale à Albi, soutenue par un grand mouvement de femmes et d’hommes dont le comité de défense de la Gynécologie médicale (CDGM), s’est développée à partir de 1998 et a abouti à la restauration de la spécialité par la création d’un DES, au sein des spécialités médicales. Au départ peu de postes à l’ECN (20) ont été attribués avec une action constante auprès des instances et des politiques pour obtenir une augmentation du nombre d’internes formés.es besoins étant majeurs du fait de l’interruption de la formation pendant 17 ans et la démographie des gynécologues médicaux baissant rapidement avec les départs à la retraite des derniers formés. Avant la suppression de la formation, environ 130 étaient formés/an. Un DESC de gynécologie médicale et médecine de la reproduction avait été obtenu après la suppression de la formation, ouvert aux gynéco-obstétriciens (dont la spécialité appartient aux spécialités chirurgicales), et aux endocrinologues. Seuls 7 internes pouvaient y avoir accès/an. Avec les actions conjointes des universitaires et du CDGM, le nombre de postes à l’ECN a doucement augmenté jusqu’à un maximum de 92, mais diminue à nouveau sans doute en raison des réformes de l’ECN et malgré des besoins loin d’être pourvus.
L’enseignement des internes, national, a été organisé dès la restauration de la spécialité et il a paru nécessaire d’organiser la vie universitaire par un Collège d’enseignants, la Fédération des collèges de gynécologie médicale (FNCGM), qui existait et regroupait 11 collèges régionaux, étant le représentant de l’exercice privé et non impliqué dans le cursus universitaire. Le Collège National des Enseignants de gynécologie médicale (CNEGM) a alors été créé, dont la première présidente en a été le Pr. Frédérique Kuttenn qui a largement contribué à la restauration de la spécialité, et moi-même comme secrétaire. Depuis la recréation de la spécialité, plus de 1000 internes sont ou ont été formés dans ce DES à ce jour, une dizaine d’universitaires ont été nommés, plus d’une centaine de PH et d’autres nominations sont en cours. Plusieurs services de gynécologie médicale ont vu le jour. C’est donc une spécialité en plein développement, dont l’exercice est complémentaire des autres praticiens impliqués dans la prise en charge des maladies des femmes. Spécialité transversale, elle s’adresse aux femmes de la puberté à la fin de leur vie pour une prise en charge de leurs problèmes gynécologiques, incluant les contraceptions compliquées, la ménopause, les troubles du cycle, les saignements et douleurs pelviennes y compris l’endométriose, l’infertilité, les pathologies mammaires, le dépistage des cancers gynécologiques et mammaires et la prise en charge après cancer des conséquences des traitements.
Pour en savoir plus : « Gynécologie médicale, une histoire de luttes » par Anne Gompel